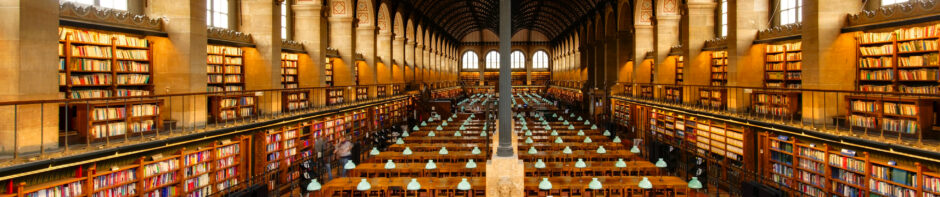Sommes-nous libres de nos opinions ?
Lorsqu’on entend Donald Trump affirmer dans ses discours qu’il « ne croit pas » au changement climatique, et qu’il se targue d’exprimer « (sa) vérité », il nous met face à un problème : peut-on vraiment penser ce qu’on veut, arguant, comme le fait Trump, que « chacun a sa vérité » ? Alors que la communauté scientifique, à l’échelle internationale, cherche à démontrer que les causes du changement climatique ont pour origine les activités humaines polluantes depuis les révolutions industrielles, elle se confronte à des « climatosceptiques », qui nient une réalité pourtant scientifiquement soutenue. En démocratie, on peut assister à un tel débat et entendre les véhémences de Mr Trump en se disant : après tout, c’est là son « opinion », chacun pense ce qu’il veut, où est le mal ? Ne sommes-nous pas libres de juger d’un énoncé comme bon nous semble ? Si l’opinion est un jugement subjectif par lequel l’individu adhère à une proposition, c’est-à-dire qu’il y donne son assentiment, ne peut-on pas, d’emblée, supposer qu’il s’agit d’un acte libre ? Mais si Trump a été réellement mis face à la vérité scientifique d’un changement climatique dont les causes sont les activités polluantes des êtres humains, et s’il choisit de ne pas y croire, de deux choses l’une : soit il rejette cette proposition car ça ne l’arrange pas, ça n’arrange pas ses « affaires », alors il nie volontairement, sciemment, cette vérité scientifique. Il serait alors dans le mensonge. Soit il n’a en réalité pas véritablement choisi de ne pas y croire ; il n’y croit pas, c’est tout. Il n’y peut rien, c’est seulement qu’il n’a pas en lui le sentiment que cette proposition puisse être vraie, il n’est ni persuadé ni convaincu. Il serait alors dans l’erreur. Dans le premier cas, on s’insurge, on crie au scandale : il n’a pas le droit de mentir ni même de se mentir à lui-même, pour des raisons morales, politiques, écologiques. Il ne peut pas, au sens où il n’en a pas le droit. Dans le second cas, on est perplexe : comment, face à la vérité, peut-on ne pas la voir ? Il ne peut pas ne pas voir la vérité, c’est trop contradictoire, car, en principe, la vérité s’impose d’elle-même ! S’il prenait le temps de lire les comptes-rendus scientifiques qui démontrent que le changement climatique est dû aux activités humaines polluantes, alors il serait forcément convaincu, et il y croirait. Dans les deux cas, on en arrive à nier sa liberté d’opinion, que les enjeux soient moraux, politiques, parce qu’on lui reproche un mensonge ; ou bien qu’ils soient existentiels et épistémologiques, parce qu’on lui reproche une erreur : Trump n’est-il pas libre de son opinion qui consiste à ne pas croire au dérèglement climatique ? Cela nous amène à deux pistes de réflexion. La question « peut-on choisir de donner -ou de ne pas donner- son assentiment à une proposition ? » se traduit en deux formulations : face à une vérité, est-il possible de ne pas être convaincu ? et : est-il moralement acceptable de nier une vérité ? Ce qui revient à se demander : une opinion est-elle un acte volontaire et libre ou bien est-ce une tendance inconsciente de l’esprit à tenir pour vraie une proposition sans le contrôle de la volonté ? Quel est le rôle de la volonté dans la formation du jugement ? Soit l’opinion repose sur une activité de l’esprit, soit elle repose sur une réception passive de l’esprit. Pour qu’on puisse maintenir l’idée de liberté, il faudrait soutenir une opinion active, et non pas une opinion reçue passivement. Mais si l’on exige que le contenu de l’opinion soit une vérité, alors où est le choix, que devient l’idée d’un acte libre, où est la liberté ? Et si je reçois passivement mes opinions, comment m’assurer qu’il s’agit bien de « mes » opinions, et non pas de celles qu’« on » m’aurait mises dans la tête ? La philosophie consiste essentiellement en une chasse contre les opinions. Non pas qu’elle nie leur existence, de fait. Mais elle cherche à développer une méfiance à l’égard des opinions, à cause de leur caractère subjectif et spontané : que je choisisse activement ou que je reçoive passivement une opinion, si je la maintiens volontairement, alors je dois me rendre capable de la justifier, et ainsi je la transforme en idée. Pour rester libre de mes opinions, je dois apprendre à penser par moi-même. Tout le problème reste alors de savoir à quelles conditions et dans quelle mesure une telle métamorphose est possible.
PLAN : Sommes-nous libres de nos opinions ?
(Attention : plan SANS RÉFÉRENCES PHILOSOPHIQUES !)
I. L’opinion relève d’un acte volontaire de la pensée : par l’affirmation de ses opinions, l’homme en assume la subjectivité et s’affirme, et c’est pourquoi nous tenons tant à nos opinions. Elles semblent dire ce que nous sommes.
- L’opinion apparaît comme une liberté individuelle, notamment lorsque l’on considère la liberté de l’exprimer. Une opinion ne dit pas tant quelque chose de la vérité de son contenu ; en revanche, elle dit quelque chose de la vérité de la personne qui s’exprime en l’exprimant. En ce sens, on peut la qualifier de « vérité subjective ». À ce compte-là, chacun pense ce qu’il veut, chacun est libre de son opinion, puisque ce genre de vérité-là devient multiple, et relative à l’individu ou même à ses origines socio-culturelles. Dans un contexte démocratique, il reste fondamental que chacun puisse exprimer son opinion (c’est une des libertés premières qu’une démocratie doit assurer aux citoyens). 12 hommes en colère: chaque juré défend son opinion, parfois explicitement ; c’est là un principe fondamental, qui garantit, dans une démocratie, la juste pratique d’une institution judiciaire. Mais on voit surtout, dans le film, que les personnages y tiennent personnellement, et non pas seulement dans le cadre de l’institution judiciaire. Ils ne sentent pas respectés s’ils ne sont pas écoutés par les autres jurés, et les relations entre eux deviennent conflictuelles lorsqu’ils ne s’écoutent pas suffisamment.
- L’opinion permet à l’individu d’agir. Si on n’est pas libre de son opinion, on n’est pas libre de son action. On devient perplexe, au sens fort du terme. Il devient impossible de décider d’un acte à accomplir. Parce qu’on ne réfléchit pas constamment à nos actions ; il arrive bien souvent qu’on se laisse agir sans que ce soit un drame ! Tout au long de notre vie, nous évoluons et apprenons à agir parmi d’autres humains qui nous éduquent, nous instruisent, nous informent, bref, nous transmettent des « données », des « croyances » (pensées, faits, théories, etc.), qui, traitées par notre esprit qui, spontanément, y adhère ou non, constituent nos opinions. Nous en avons besoin pour grandir, construire notre représentation du monde, et agir dans ce monde. D’une certaine manière, dans 12 hommes en colère, les jurés doivent s’en tenir à leur opinion pour pouvoir se prononcer et décider s’ils acquittent ou condamnent l’accusé, puisque, de toutes façons, ils ne sauront jamais s’il était réellement coupable ou non coupable. Pour que leur décision, et donc ici leur action, soit possible, il faut qu’ils s’appuient sur quelque chose qui ne peut être que de l’ordre de l’opinion et non pas de la certitude. On ne leur demande finalement pas autre chose, puisqu’ils n’ont pas les moyens de connaître à coup sûr la vérité sur les faits dont il est question.
- Nous avons besoin de nos opinions pour penser: c’est peut-être le point de départ de toute connaissance, et donc, a priori, de toute idée vraie. L’opinion apparaît alors comme, paradoxalement, le point de départ, le premier degré d’une pensée libre. C’est une sorte de passage inévitable qui n’est pas à déplorer.
II. Mais non seulement les opinions ne naissent pas ex nihilo, mais en outre, elles ne sont jamais absolument fiables. On ne choisit pas ses opinions ; on en serait plutôt les victimes ! Il faut donc s’en méfier, car elles peuvent nous abuser.
- Nos opinions viennent d’autrui et il semblerait que nous les recevions passivement, plutôt que de les construire activement, librement, par la volonté. Leur caractère « personnel » est illusoire : si j’entreprends de « déconstruire » une opinion, d’en mener la généalogie, je trouve systématiquement qu’elle vient de quelque part, c’est-à-dire de quelqu’un d’autre que moi. Ce que je prends pour l’affirmation de ma liberté (je pense ce que je veux, je pense par moi-même, je suis autonome) n’est peut-être en réalité que l’affirmation de mon hétéronomie et la confirmation désespérante du déterminisme social: je me laisse dicter mes jugements par mes éducateurs, instructeurs, informateurs, ainsi que de ceux de mes ancêtres, car cette généalogie peut mener très loin et nous faire remonter jusqu’aux fondements de notre civilisation…
- Les opinions peuvent être trompeuses aussi dès lors qu’elles sont fondées sur l’expérience, les sens. Si j’adhère un peu trop passivement aux apparences, je peux me laisser abuser et être victime d’illusion. De plus, je peux être trompé par mes émotions, mes préjugés, etc. et par ce que les neuroscientifiques appellent les biais cognitifs. L’inconscient agit sourdement et nie ma liberté dans la naissance de mes opinions, qui, alors, ne relèvent plus que d’une illusion d’acte de la volonté. Dans 12 hommes en colère, même les témoins deviennent suspects! Ont-ils bien perçu ce qu’ils pensent avoir perçu ? Pour certains cas, rien n’est moins sûr… C’est ce qui met un doute dans l’esprit du juré n°8, puis d’autres jurés.
- Victimes de nos opinions, nous devons nous en libérer. Si je cherche la vérité, celle qu’il faut entendre dans son sens traditionnel, avec toutes les caractéristiques requises : éternelle, absolue, immuable, certaine, sans contradiction, une, alors nos opinions sont à combattre sans répit, car elles sont temporaires, relatives, changeantes, incertaines, contradictoires et diverses. Il y a un chemin à parcourir qui nous mène à nous débarrasser de nos opinions car elles nous aliènent en nous enfermant dans un monde illusoire.
III. Pouvons-nous « sauver » nos opinions ? Existe-t-il des conditions qui rendent nos opinions supportables ? (double sens de « supportables » : au sens où on se rend capable de les subir sans en pâtir, comme une « douleur supportable », et au sens où on se rend capable de les soutenir, de les défendre, comme on « supporte » une équipe sportive). Quelle que soit l’idée que nous nous faisons de nos opinions (qu’elles soient ressenties comme l’expression libre de notre personnalité ou au contraire comme le fléau de l’humanité qui -si nous n’en sortons pas- nous condamne à l’ignorance et la bêtise), il semble d’une part qu’elles soient inévitables, et d’autre part et du même coup, qu’elles nous obligent à en faire quelque chose. En ce sens, nous sommes libres de nos opinions au sens où nous en sommes responsables. Alors, que pouvons-nous faire de nos opinions ?
- De la nécessité de « suspendre son jugement » (scepticisme) ou, à tout le moins, de s’abstenir de l’exprimer, se mettre en mesure de le mettre entre parenthèses. + 12 hommes en colère, réplique du juré n°8 après le discours raciste du juré n°10, sur la difficulté à nous défaire de nos opinions, qu’il faut savoir mettre en suspens lorsqu’il s’agit de juger (« juger » peut ici s’entendre au sens juridique, mais aussi moral et épistémologique). + importance du doute, exprimée déjà par l’institution de la justice: en cas de « doute raisonnable », je m’abstiens de condamner l’accusé et je vote « non coupable » pour éviter l’injustice. Du point de vue épistémique maintenant, je vais donc mettre en doute mes opinions pour m’en libérer, et m’assurer d’arriver à un « degré zéro » de la connaissance, à partir duquel je vais pouvoir tout reprendre avec davantage de certitude. Tabula rasa.
- De la nécessité de mettre nos opinions à l’épreuve de l’examen. Prendre le temps de la généalogie d’une opinion, prendre le temps d’en chercher les justifications, d’argumenter, semble le minimum requis pour l’assumer. Seulement, une fois que ce véritable travail aura été fourni, on arrive au problème suivant : s’agit-il encore d’une opinion, ou bien s’agit-il maintenant d’une idée, d’une pensée ? Il semble qu’il s’agisse en effet plutôt d’une idée, d’une pensée. C’est ce qu’on nous demande de faire en philosophie. Mais alors, cela ne revient-il pas à détruire nos opinions, puisqu’il y a eu transformation de nos opinions en idées ? Qu’il soit encore permis de douter. Sans basculer dans un scepticisme radical, les limites de l’humain nous invitent à la prudence. Pour assumer mes opinions, quand bien même je les prends désormais pour de véritables idées, qui témoigneraient bel et bien du fait que je pense enfin par moi-même, je dois faire preuve de certaines vertus intellectuelles, à commencer par le courage intellectuel. C’est le prix à payer pour m’assurer, peut-être pas d’une vérité absolue, éternelle, immuable, une, certaine, et sans contradiction, mais tout du moins de la construction d’une pensée réellement intelligente, ce qui n’est pas rien ! ou de ce qu’on peut appeler une « vérité philosophique », qui m’engage pleinement. Dans 12 hommes en colère, le juré n°8 commence par ce qui nous semble maintenant évident: il faut prendre le temps de réfléchir pour construire son opinion, s’apprêter à être réfuté, remis en question, prendre le temps d’une véritable délibération. Même une heure… « on lui doit bien ça ».
- De la nécessité de mettre nos opinions à l’épreuve de leurs conséquences pratiques. Enfin, si nous sommes ainsi devenus libres de nos opinions, reste un dernier point d’ordre pratique, c’est-à-dire moral, politique et juridique : que fontnos opinions ? Quels effets produisent-elles ? A quoi nous engagent-elles ? Que font-elles à autrui ? Sont-elles compatibles avec l’idée de vivre en société ? Toute liberté, tout acte libre, tout acte de la volonté, implique une responsabilité. Si je suis libre de mes opinions, j’en suis donc responsable. Si nous reprenons notre amorce, avec l’exemple de Trump qui « ne croit pas au dérèglement climatique », nous percevons le problème dans sa dimension morale et politique : les conséquences de l’expression d’une telle opinion sont énormes, puisqu’elle a des répercussions sur les décisions concernant l’écologie (les lois sont alors susceptibles de changer, et c’est ce qu’il se passe : les lois qui protègent l’environnement sont mises à rude épreuve aux Etats-Unis depuis que Trump a repris le pouvoir…).