Voyages, coffrets magiques aux promesses rêveuses, vous ne livrerez plus vos trésors intacts. Une civilisation proliférante et surexcitée trouble à jamais le silence des mers. Les parfums des tropiques et la fraîcheur des êtres sont viciés par une fermentation aux relents suspects, qui mortifie nos désirs et nous voue à cueillir des souvenirs à demi corrompus.
Aujourd’hui où des îles polynésiennes noyées de béton sont transformées en porte-avions pesamment ancrés au fond des mers du Sud, où l’Asie tout entière prend le visage d’une zone maladive, où les bidonvilles rongent l’Afrique, où l’aviation commerciale et militaire flétrit la candeur de la forêt américaine ou mélanésienne avant même d’en pouvoir détruire la virginité, comment la prétendue évasion du voyage pourrait-elle réussir autre chose que nous confronter aux formes les plus malheureuses de notre existence historique ? Cette grande civilisation occidentale, créatrice des merveilles dont nous jouissons, elle n’a certes pas réussi à les produire sans contrepartie. Comme son œuvre la plus fameuse, pile où s’élaborent des architectures d’une complexité inconnue, l’ordre et l’harmonie de l’occident exigent l’élimination d’une masse prodigieuse de sous-produits maléfiques dont la terre est infectée. Ce que d’abord vous nous montrez, voyages, c’est notre ordure lancée au visage de l’humanité.
Je comprends alors la passion, la folie, la duperie des récits de voyage. Ils apportent l’illusion de ce qui n’existe plus et qui devrait être encore, pour que nous échappions à l’accablante évidence que vingt-mille ans d’histoire sont joués. Il n’y a plus rien à faire : la civilisation n’est plus cette fleur fragile qu’on préservait, qu’on développait à grand peine dans quelques coins abrités d’un terroir riche en espèces rustiques, menaçantes sans doute par leur diversité, mais qui permettaient aussi de varier et de revigorer les semis. L’humanité s’installe dans la monoculture, elle s’apprête à produire la civilisation en masse, comme la betterave. Son ordinaire ne comporte plus que ce plat.
On risquait jadis sa vie dans les Indes ou aux Amériques pour rapporter des biens qui nous paraissent aujourd’hui dérisoires : bois de braise (d’où Brésil) : teinture rouge, ou poivre dont, au temps d’Henri IV, on avait à ce point la folie que la Cour en mettait dans des bonbonnières des grains à croquer. Ces secousses visuelles ou olfactives, cette joyeuse chaleur pour les yeux, cette brûlure exquise pour la langue ajoutaient un nouveau registre au clavier sensoriel d’une civilisation qui ne s’était pas doutée de sa fadeur. Dirons-nous alors que, par un double renversement, nos modernes Marco-Polo rapportent de ces mêmes terres, cette fois sous forme de photographies, de livres et de récits, les épices morales dont notre société éprouve un besoin plus aigu en se sentant sombrer dans l’ennui ?
Un autre parallèle me semble plus significatif. Car ces modernes assaisonnements sont, qu’on le veuille ou non, falsifiés. Non certes parce que leur nature est purement psychologique ; mais parce que, si honnête que soit le narrateur, il ne peut pas, il ne peut plus nous les livrer sous une forme authentique. Pour que nous consentions à les recevoir, il faut, par une manipulation qui chez les plus sincères est seulement inconsciente, trier et tamiser les souvenirs, et substituer le poncif au vécu. J’ouvre ces récits d’explorateurs : telle tribu, qu’on me décrit comme sauvage et conservant jusqu’à l’époque actuelle les mœurs de je ne sais quelle humanité primitive caricaturée en quelques légers chapitres, j’ai passé des semaines de ma vie d’étudiant à annoter les ouvrages que, voici cinquante ans, parfois même tout récemment, des hommes de science ont consacrés à son étude, avant que le contact avec les blancs et les épidémies subséquentes ne l’aient réduite à une poignée de misérables déracinés.
Cet autre groupe, dont l’existence, dit-on, a été découverte et l’étude menée en quarante-huit heures par un voyageur adolescent, il a été entrevu (et ce n’est pas négligeable) au cours d’un déplacement hors de son territoire dans un campement provisoire, naïvement pris pour un village permanent. Et on a minutieusement gazé les méthodes d’accès, qui auraient révélé le poste missionnaire depuis vingt ans en relations permanentes avec les indigènes, la petite ligne de navigation à moteur qui pénètre au plus profond du pays, mais dont l’œil entraîné infère aussitôt l’existence d’après de menus détails photographiques, le cadrage n’ayant pas toujours réussi à éviter les bidons rouillés où cette humanité vierge fait sa popote. La vanité de ces prétentions, la crédulité naïve qui les accueille et même les suscite, le mérite enfin qui sanctionne tant d’efforts inutiles (si ce n’est qu’ils contribuent à étendre la détérioration qu’ils s’appliquent par ailleurs à dissimuler), tout cela implique des ressorts psychologiques puissants, tant chez les acteurs que dans leur public, et que l’étude de certaines institutions indigènes peut contribuer à mettre à jour. Car l’ethnographie doit aider à comprendre la mode qui attire vers elle tous ces concours qui la desservent.
Claude Levi-Strauss, Tristes Tropiques, 1955
Contraction (10 points) : Résumez le texte de Levi-Strauss en le réduisant à 200 mots environ (minimum 180 et maximum 220). N’oubliez pas d’indiquer au fur et à mesure le nombre de mots que votre contraction comprend.
Essai (10 points) : Que peut nous apprendre la rencontre avec une autre civilisation que la nôtre ?
→ Vous développerez de manière organisée votre réponse à cette question, en prenant appui sur les Essais de Montaigne, sur le texte de Levi-Strauss, et sur ceux que vous avez étudiés dans l’année dans le cadre de l’objet d’étude « La littérature d’idées du XVIème au XVIIIème siècle ». Vous pourrez aussi faire appel à vos lectures et à votre culture personnelles.
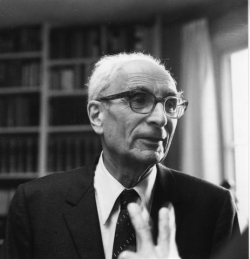
Claude Levi-Strauss

